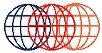
LA RÉAPPARITION DES MALADIES INFECTIEUSES
Laurie Garrett
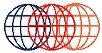
LA RÉAPPARITION DES MALADIES INFECTIEUSES
Laurie Garrett
Le processus de sélection naturelle qui, selon Charles Darwin, constitue le mécanisme de l'évolution, est évident dans le monde des bactéries et des virus, et ce fait représente un gros obstacle pour les scientifiques qui s'efforcent de limiter l'expansion des maladies infectieuses.
La période post-antibiotique
Après la Deuxième Guerre mondiale, la stratégie des responsables de la santé publique a consisté à mettre l'accent sur l'élimination des microbes. Recourant aux armes médicales puissantes mises au point après la guerre - antibiotiques, antipaludéens et vaccins - les responsables politiques et scientifiques des États-Unis et des autres pays menèrent une campagne de style militaire de façon à juguler ces ennemis de l'homme que sont les virus, les bactéries et les parasites. L'objectif consistait à faire passer l'humanité par ce qu'ils appelaient « la transition sanitaire », à reléguer dans le passé l'ère des maladies infectieuses. On pensait alors que, vers la fin du siècle, la majeure partie des habitants de la planète mèneraient une longue vie à laquelle ne mettraient fin que les maladies « chroniques », telles le cancer, les maladies cardiaques, et la maladie d'Alzheimer (démence présénile).
Cet optimisme atteignit son comble en 1978 quand les pays membres des Nations unies signèrent l'accord intitulé La santé pour tous en l'an 2000. Cet accord établissait des objectifs ambitieux d'éradication de la maladie, prévoyait que même les pays les plus pauvres connaîtraient cette « transition sanitaire » avant la fin du siècle, et que l'espérance de vie y augmenterait considérablement. Certes, on avait de bonnes raisons, en 1978, de se montrer optimiste quant à l'issue de la lutte séculaire de l'homme contre les microbes. En effet, les antibiotiques, les insecticides, la chloroquine, les produits bactéricides, les vaccins et les améliorations remarquables apportées aux techniques de traitement de l'eau et de préparation des aliments, fournissaient ce qui semblait constituer un imposant arsenal. L'année précédente, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait annoncé que le dernier cas connu de variole avait été dépisté en Éthiopie et guéri.
Ce grand optimisme reposait sur deux hypothèses erronées : la première, que les microbes étaient des cibles stationnaires sur le plan biologique et la seconde, que les maladies pouvaient être géographiquement circonscrites. Chacune de ces hypothèses contribuait à la confiance béate dans l'immunité contre les maladies infectieuses qui caractérisait les milieux médicaux de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Or, loin d'être stationnaires, les microbes, les insectes, les rongeurs et autres vecteurs de maladies infectieuses, sont dans un état constant d'adaptation et d'évolution. Charles Darwin notait que certaines mutations génétiques permettaient aux plantes et aux animaux de s'adapter aux conditions du milieu et donc d'avoir une progéniture plus nombreuse ; ce processus de sélection naturelle, disait-il, constituait le mécanisme de l'évolution. Moins de dix ans après que l'Armée américaine eut fourni pour la première fois de la pénicilline à ses médecins, sur le front du Pacifique, le généticien Joshua Lederberg prouva que la sélection naturelle s'opérait dans le monde des bactéries. Des souches de staphylocoques et de streptocoques ayant des gènes leur permettant de résister aux médicaments apparurent et prospérèrent là où avaient été éradiquées des souches de ces bactéries répondant à un traitement. Le recours aux antibiotiques entraînait l'apparition de micro-organismes encore plus résistants.
Récemment, les scientifiques ont observé un mécanisme alarmant d'adaptation et de changement chez les microbes, un mécanisme dépendant moins d'avantages génétiques héréditaires. Le schéma génétique de certains microbes contient des codes ADN et ARN qui déclenchent une mutation en cas de tension, aident le microbe à se soustraire à l'effet des antibiotiques et autres médicaments, provoquent un comportement collectif propice à la survie du groupe et permettent aux microbes et à leur progéniture de sillonner leur milieu à la recherche de matériel génétique susceptible de leur être utile. Un tel matériel est présent dans les fragments circulaires d'ADN et d'ARN connus sous le nom de plasmides et transposons, qui évoluent librement parmi les micro-organismes et sont capables de s'insérer dans d'autres espèces de bactéries, de champignons et de parasites. Certains plasmides sont porteurs de gènes résistant à cinq familles d'antibiotiques ou plus, ou à des douzaines de médicaments différents. D'autres confèrent aux microbes de grands pouvoirs d'infection, de virulence, de résistance aux désinfectants ou au chlore, et même des caractéristiques subtiles aussi importantes que la capacité de tolérer des températures plus élevées ou des degrés d'acidité plus grands. On a assisté à l'apparition de microbes qui peuvent se multiplier sur un pain de savon, évoluer librement dans de l'eau de Javel et rester réfractaires à des doses de pénicilline bien plus importantes que celles qui s'avéraient efficaces en 1950.
Il existe donc, dans le monde microbien, une collection constamment changeante de matériel génétique qui donne aux microscopiques prédateurs dont souffre l'humanité quantité de moyens de déjouer l'arsenal pharmaceutique, un arsenal limité en dépit des apparences. En 1994, l'Administration fédérale des produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) n'a homologué que trois nouveaux médicaments antimicrobiens, dont deux pour le traitement du sida, et aucun d'eux n'était bactéricide. Les recherches théoriques et pratiques sont pratiquement au point mort maintenant que l'on a exploité les solutions faciles pour détruire les virus, les bactéries, les champignons et les parasites, c'est-à-dire celles qui imitent les façons dont des microbes rivaux se détruisent mutuellement dans les petites batailles sans fin qu'ils se livrent dans l'appareil gastro-intestinal de l'homme. Les chercheurs sont à court d'idées sur les moyens de contrecarrer de nombreux fléaux microbiens et le manque de rentabilité de leurs travaux a entravé la mise au point de médicaments permettant de lutter contre des organismes que l'on trouve principalement dans les pays pauvres. « Le pipeline est à sec. Nous sommes en proie à une réelle crise mondiale », déclarait récemment M. James Hughes, directeur du « Centre national des maladies infectieuses » auprès du Centre fédéral de lutte contre les maladies (CDC), qui est situé à Atlanta.
Des maladies sans frontières
Dans les années 1960, 1970 et 1980, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont élaboré des politiques d'investissement qui partaient du principe que la modernisation économique devait venir en premier et que l'amélioration de la santé publique en découlerait tout naturellement. À présent, la Banque mondiale reconnaît qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'un pays dont plus de 10% des habitants en âge de travailler souffrent de maladies chroniques atteigne un niveau plus élevé de développement sans investir dans son infrastructure sanitaire. La Banque reconnaît en outre que peu de pays utilisent efficacement les fonds prévus pour la santé publique au profit des pauvres pour qui le risque d'épidémies de maladies infectieuses est le plus grand. La plupart des succès remportés en matière de lutte contre les maladies infectieuses ont résulté de vastes initiatives internationales, telles le programme élargi d'immunisation enfantine lancé par le Fonds des Nations unies pour l'enfance et la campagne d'éradication de la variole entreprise par l'OMS. Au niveau local, notamment dans les pays pauvres en proie à l'instabilité politique, peu de succès véritables peuvent être cités.
Circonscrire géographiquement les maladies infectieuses revêtait une importance cruciale dans la planification sanitaire d'après-guerre, mais on ne peut plus s'attendre que les maladies soient confinées à leur pays ou région d'origine. Avant même l'avènement de l'aviation commerciale, la grippe espagnole avait réussi, en 1918-19, à faire cinq fois le tour de la planète en l'espace de dix-huit mois, tuant vingt-deux millions de personnes, dont cinq cent mille aux États-Unis. Combien de victimes une souche aussi meurtrière de grippe pourrait-elle faire en 1996, alors que cinq cents millions de personnes voyageront par avion ?
Un million de personnes franchissent chaque jour une frontière internationale. Un million de personnes voyagent chaque semaine entre les pays industriels et les pays en voie de développement. Et quand les gens se déplacent, des microbes indésirables les accompagnent. Au XIXe siècle, la plupart des maladies et infections dont les voyageurs étaient porteurs se manifestaient durant les longs voyages en bateau qui étaient le moyen principal de parcourir de grandes distances. Lorsqu'elles reconnaissaient les symptômes d'une maladie, les autorités du port d'entrée pouvaient mettre en quarantaine les personnes atteintes d'une maladie contagieuse ou prendre d'autres mesures. À l'ère des voyages aériens toutefois, une personne qui couve une maladie comme la fièvre d'Ebola peut prendre l'avion, parcourir dix-huit mille kilomètres, passer les contrôles de la douane et des services d'immigration d'un pays sans que son état de santé suscite de suspicion, emprunter ensuite une ligne aérienne locale pour se rendre à une destination lointaine et ne pas manifester de symptômes de la maladie avant plusieurs jours, risquant ainsi d'infecter beaucoup de gens avant qu'on ne se rende compte de son état.
Le contrôle sanitaire aux aéroports s'avère tout à fait insuffisant. Il est souvent irrationnel sur le plan biologique étant donné que la période d'incubation de nombreuses maladies contagieuses incurables peut dépasser vingt et un jours. Et lorsque les symptômes deviennent visibles chez un voyageur, des jours ou même des semaines après son déplacement, il est coûteux, parfois même impossible, d'identifier ses compagnons de voyage, de les retrouver et de les convoquer devant les autorités sanitaires en vue d'un examen médical. En 1976, les gouvernements britannique et américain ont dépensé des millions de dollars lorsqu'ils ont essayé de retrouver les cinq cent vingt-deux personnes qui, durant un vol parti de la Sierra-Léone à destination de Washington, avaient été exposées au virus de la fièvre de Lassa dont était atteint un volontaire du Corps de la paix. Ce virus cause une grave fièvre hémorragique. Le gouvernement américain finit par localiser cinq cent cinq passagers, disséminés dans vingt et un États ; la compagnie aérienne « British Airways » et le gouvernement britannique en retrouvèrent quatre-vingt-quinze, dont certaines figuraient déjà sur la liste des autorités américaines. Les analyses permirent d'établir qu'aucune de ces personnes n'avait contracté le virus en question.
Durant l'automne de 1994, les services de santé de la ville de New-York et les services fédéraux d'immigration et de naturalisation prirent des mesures visant à empêcher les passagers en provenance d'Inde qui seraient porteurs du virus de la peste de débarquer à l'aéroport international John Kennedy, à New-York. On apprit à tout le personnel de l'aéroport et au personnel fédéral qui avait un contact direct avec les voyageurs à reconnaître les symptômes de cette maladie (Yersinia pestis) afin qu'ils puissent aider à identifier les porteurs éventuels du microbe de la peste avant qu'ils ne quittent la piste d'atterrissage et que les gens qui avaient pris le même avion qu'eux puissent être examinés par un médecin. Sur les dix porteurs éventuels du microbe, deux seulement furent découverts à l'aéroport ; les autres avaient intégré depuis longtemps la collectivité. Il s'avéra heureusement qu'aucune des dix personnes en question n'était atteinte de la peste. Les autorités sanitaires en conclurent que le dépistage dans les aéroports était coûteux et inefficace.
La population mondiale est constamment en mouvement, fuyant la pauvreté, l'intolérance religieuse et ethnique et les intenses guerres locales qui ciblent la population civile. En 1994, cent dix millions de personnes au moins ont émigré, trente millions d'autres ont, dans leur propre pays, quitté les zones rurales pour la ville et vingt-trois millions d'autres ont été déplacées par la guerre ou les troubles sociaux, selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le « Worldwatch Institute ». Cette mobilité humaine offre aux microbes des possibilités accrues de déplacement.
La ville et son rôle de vecteur
L'expansion démographique accroît la probabilité statistique de transmission des agents pathogènes, que ce soit d'une personne à l'autre ou que ce soit par le truchement d'un vecteur (insecte, rongeur ou autre). La densité démographique s'intensifie rapidement dans le monde. Sept pays ont maintenant une densité de population supérieure à sept cent soixante-dix habitants au kilomètre carré et quarante-trois en comptent plus de deux cents. (La moyenne aux États-Unis est de vingt-huit.)
Une telle densité ne condamne pas nécessairement un pays aux épidémies si les égouts et réseaux d'adduction d'eau, les conditions de logement et les mesures de santé publiques y sont satisfaisants. C'est ainsi que les Pays-Bas, qui comptent quatre cent cinquante personnes au kilomètre carré, se classent parmi les vingt pays dans lesquels les conditions sanitaires et l'espérance de vie sont les plus élevées. Mais les zones dans lesquelles la densité s'accroît le plus ne sont pas en mesure de se doter de l'infrastructure nécessaire, car il s'agit des pays les plus pauvres du monde. Sur le plan de la santé publique, même les pays qui ont une faible densité démographique peuvent avoir des villes dangereusement surpeuplées. Certaines de ces agglomérations urbaines comptent un cabinet d'aisances pour sept cent cinquante personnes ou plus.
Ce sont les villes à croissance rapide comme Surat, en Inde, (où la peste pulmonaire a frappé en 1994) et Kikwit, au Zaïre, (où a éclaté l'épidémie de fièvre hémorragique de 1995), dont les équipements collectifs laissent souvent à désirer, qui attirent les gens. Ces nouveaux centres d'urbanisation n'ont généralement pas suffisamment d'égouts, de routes, de logements, d'eau potable, d'établissements médicaux et d'écoles, ne serait-ce que pour satisfaire les besoins de leurs habitants les mieux nantis. Ce sont des zones sordides, plongées dans une misère noire, où des centaines de milliers de gens vivent dans des conditions comparables à celles des villages pauvres, mais où ils sont tellement entassés qu'ils favorisent une rapide transmission des maladies par voie aérienne, hydrique, sexuelle ou par simple contact.
De tels centres ne constituent souvent qu'une étape pour les vagues de pauvres qu'ils attirent. La destination suivante de ces gens est une ville de dix millions d'habitants ou plus. Au XIXe siècle, deux villes seulement, Londres et New-York, avaient une telle importance. Dans cinq ans, il y en aura vingt-quatre et la plupart d'entre elles (Sao-Paulo, Calcutta, Bombay, Istanbul, Bangkok, Téhéran, Djakarta, Le Caire, Mexico, Karachi, etc) seront situées dans des pays pauvres en voie de développement. Dans ces mégalopoles, les problèmes qui affligent des villes comme Surat sont considérablement amplifiés. Et pourtant, même les mégalopoles du monde en voie de développement ne sont qu'une station de transit pour ceux qui recherchent le plus activement une vie meilleure. Tous les chemins finissent par mener ces gens - et les microbes dont ils peuvent être porteurs - aux États-Unis, au Canada et en Europe occidentale.
L'urbanisation et la migration mondiale entraînent des changements radicaux dans le comportement humain ainsi que dans les rapports écologiques entre les microbes et l'homme. Dans les grandes villes, l'industrie de la prostitution fait presque immanquablement son apparition et la multiplicité des partenaires sexuels devient courante, entraînant une rapide progression des maladies vénériennes. L'acquisition de produits antimicrobiens au marché noir, qui est relativement facile dans les centres urbains, conduit à un usage abusif ou à une mauvaise utilisation de précieux médicaments et à l'apparition de bactéries et de parasites qui y deviennent résistants. L'habitude qu'ont les toxicomanes de partager leurs seringues contribue également à la transmission des microbes. Souvent, au lieu d'enrayer les maladies infectieuses, les dispensaires, dont le budget est insuffisant, deviennent des centres de propagation de maladies.
Une nouvelle maladie
Tous ces facteurs se sont manifestés de façon spectaculaire durant les années 1980, permettant à un obscur micro-organisme de se développer et de se répandre à tel point que l'OMS estime qu'il a infecté au total trente millions de personnes et qu'il est devenu endémique dans tous les pays de la planète. Les études génétiques du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) responsable du sida montrent que ce virus existait probablement déjà il y a une centaine d'années, mais que, jusqu'au milieu des années 1970, il infectait moins de 0,001% de la population mondiale. Il s'est rapidement propagé dans le monde entier en raison d'importants changements sociaux : l'urbanisation africaine, l'utilisation de la drogue par voie intraveineuse aux États-Unis et en Europe, la fréquentation des bains de vapeur par les homosexuels, la guerre de 1977-79 entre l'Ouganda et la Tanzanie durant laquelle le viol était utilisé aux fins de purification ethnique, l'expansion de l'industrie américaine des produits dérivés du sang et la commercialisation internationale de produits sanguins contaminés. Partout dans le monde, les démentis des gouvernements et les préjugés de la société ont conduit à des interventions insuffisantes ou même à une inaction totale de la part des responsables de la santé publique, ce qui a encore contribué à la transmission du VIH et ralenti les recherches sur le traitement ou l'élimination du sida.
Selon la « Global AIDS Policy Coalition », de l'université Harvard, le coût direct (médical) et indirect (diminution de productivité de la main-d'œuvre et répercussions sur les familles) du sida devrait dépasser cinq cents milliards de dollars d'ici à l'an 2000. L'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) prévoit que, d'ici là, environ 11% des enfants d'Afrique noire âgés de moins de quinze ans seront orphelins à cause du sida, et que la mortalité infantile quintuplera dans certains pays d'Afrique et d'Asie en raison de l'absence de soins parentaux dont souffriront les enfants rendus orphelins par le sida et par la tuberculose, maladie que le sida favorise. L'USAID prévoit aussi que, d'ici à 2010, l'espérance de vie tombera au niveau extraordinairement bas de vingt-cinq ans dans les pays d'Afrique et d'Asie les plus durement touchés par le sida.
Les experts médicaux reconnaissent maintenant que tout microbe, y compris ceux que la science n'a pas encore identifiés jusqu'ici, peut exploiter certaines conditions humaines, transformant quelques cas isolés, camouflés par un niveau élevé de morbidité, en une menace pour le monde entier. De plus, aidés par la mauvaise utilisation que l'homme a faite des désinfectants et des produits pharmaceutiques, des micro-organismes anciens peuvent prendre de nouvelles formes beaucoup plus meurtrières.
Un groupe de travail interministériel chargé par la Maison-Blanche de se pencher sur l'apparition et le retour de certaines maladies infectieuses estime qu'au moins vingt-neuf maladies jusque-là inconnues ont fait leur apparition depuis 1973 et que vingt maladies que l'on croyait maîtrisées sont réapparues, souvent sous des formes extrêmement meurtrières résistant aux médicaments. Selon ce groupe, le coût direct et indirect des maladies infectieuses aux États-Unis a dépassé cent vingt milliards de dollars en 1973. Par ailleurs, les sommes dépensées cette année-là par le gouvernement fédéral, les États et les municipalités pour la prévention des maladies infectieuses n'avaient atteint qu'un peu plus de soixante-quatorze millions de dollars (aucun de ces chiffres ne tient compte des dépenses occasionnées par le sida, les maladies vénériennes ou la tuberculose).
La menace réelle d'une guerre biologique
Le monde a eu de la chance, lors de l'épidémie de peste pulmonaire qui a éclaté à Surat en septembre 1994. Des études indépendantes menées aux États-Unis, en France et en Russie ont révélé que la souche de la bactérie responsable de cette épidémie était anormalement faible et, bien que le nombre précis de cas de peste et de ses victimes continue à faire l'objet d'une controverse, le nombre de victimes a certainement été inférieur à deux cents. Cette épidémie a cependant mis a jour trois éléments importants pour notre sécurité nationale : la mobilité humaine, la transparence et les tensions entre États, y compris la menace de guerre biologique.
Dès que se répandit la nouvelle qu'une maladie contagieuse à transmission aérienne s'était déclarée à Surat, dans les quarante-huit heures, quelque cinq cent mille personnes quittèrent cette ville en chemin de fer et se dispersèrent aux quatre coins du pays. Si le microbe responsable de la peste avait été une bactérie résistant aux médicaments, le monde aurait immédiatement été le témoin d'une pandémie asiatique. En fait, cette épidémie déclencha dans le monde une panique qui coûta au gouvernement indien un minimum de deux milliards de dollars sous forme de manque à gagner et de pertes à la bourse de Bombay, principalement en raison du boycottage, par l'étranger, des produits indiens et du tourisme en Inde.
Devant le nombre croissant de pays qui interdirent le commerce avec l'Inde cet automne-là, la presse de langue hindi nia l'existence de la peste, accusant le Pakistan d'être à l'origine d'une campagne de dénigrement ayant pour but de ruiner l'économie indienne. Lorsque des enquêtes scientifiques internationales eurent conclu qu'il s'était bien agi d'une épidémie de peste (Yersinia pestis), l'attention se porta sur l'origine de la bactérie en question. En juin dernier, plusieurs scientifiques indiens ont affirmé posséder la preuve que la bactérie impliquée dans l'épidémie de Surat avait été intentionnellement synthétisée à des fins de guerre biologique. Bien qu'une telle affirmation ne repose sur aucune preuve crédible et que le gouvernement indien l'ait catégoriquement démentie, il est quasiment impossible d'en démontrer la fausseté, en particulier dans une région en proie à des tensions militaires et politiques de longue date.
Même quand les allégations de guerre biologique ne sont pas avancées, il est souvent très difficile d'obtenir des renseignements exacts sur la poussée d'une maladie, en particulier quand celle-ci a son origine dans des pays qui dépendent des investissements ou du tourisme étranger, ou des deux à la fois. Le manque de transparence est un problème courant ; bien qu'il ne s'agisse généralement pas d'une volonté de dissimulation ou d'intentions malveillantes, un grand nombre de pays hésitent à donner des renseignements complets sur les maladies contagieuses. Ainsi, pratiquement tous les pays ont commencé par nier ou cacher la présence du virus du sida sur leur territoire. Même à l'heure actuelle, au moins dix pays que l'on sait victimes d'une épidémie de VIH refusent de coopérer avec l'OMS, dissimulant délibérément les rapports médicaux ou refusant de fournir des statistiques à ce sujet.
Le spectre de la guerre biologique ayant fait son apparition, Brad Roberts, du « Center for Strategic and International Studies », craint que des pays en voie de développement comme la Chine, l'Irak et l'Iran, qui possèdent les connaissances techniques nécessaires, mais n'ont pas une société civile susceptible d'en restreindre l'usage, ne soient tentés d'utiliser les armes biologiques. La Fédération des scientifiques américains a cherché, en vain jusqu'à maintenant, à remédier scientifiquement à l'extrême faiblesse des clauses de vérification et d'application contenues dans la Convention de 1972 sur les armes biologiques, que la plupart des pays ont signée.
Les lacunes de ce traité et le risque très réel d'un recours aux armes biologiques sont actuellement très évidents. Face à la menace d'un recours aux armes biologiques proférée par l'Irak en 1990-91, pendant la guerre du Golfe, les forces alliées dans la région étaient pratiquement impuissantes : l'existence de ces armes n'avait pas été vérifiée en temps opportun, la seule contre-mesure dont on disposait était un vaccin contre un seul type d'organisme et les tenues et l'équipement de protection des militaires ne résistaient pas aux rafales de sable. En juin dernier, le Conseil de sécurité a conclu que l'Irak avait peut-être reconstitué ses stocks d'armes biologiques après la fin de la guerre du Golfe.
Les agissements du culte Aum Shinrikyo, au Japon, au début de 1995, ont été encore plus inquiétants. En plus du lâcher de gaz toxique, le sarin, dans le métro de Tokyo le 18 mars, les membres de ce culte préparaient de vastes quantités de spores de Clostridium à des fins terroristes. Bien qu'elles soient rarement fatales, les infections à Clostridium sont souvent aggravées par une mauvaise utilisation des antibiotiques et par de longs accès de diarrhée sanglante qui provoquent une dangereuse inflammation du colon. Le Clostridium est un bon choix pour des terroristes étant donné que ses spores peuvent survivre pendant des mois, qu'on peut les répandre à l'aide d'une vulgaire bombe à aérosol et que le moindre contact peut rendre les personnes vulnérables, notamment les enfants et les personnes âgées, suffisamment malades pour que les frais d'hospitalisation et les pertes de productivité dans un pays très peuplé comme le Japon se chiffrent à des millions de dollars.
Le Bureau fédéral d'évaluation des techniques (U.S. Office of Technology Assessment) a calculé ce qu'il faudrait aux terroristes pour produire une arme biologique aux effets spectaculaires. Cent kilos d'un micro-organisme mortel à spores comme l'anthrax, lâchés au-dessus de Washington par un avion-pulvérisateur, pourraient faire plus de deux millions de morts. À New-York, une quantité de spores d'anthrax suffisante pour tuer de cinq à six millions de personnes pourrait être placée à bord d'un taxi qui sillonnerait la ville en dispersant les spores par son pot d'échappement. La vulnérabilité aux attaques terroristes et à l'apparition naturelle de la maladie augmente en fonction de la densité de la population.
Un monde en péril
Une étude réalisée en 1995 par l'OMS afin d'évaluer la capacité qu'a le monde d'identifier les menaces représentées par les nouvelles maladies et à y réagir a conduit à des conclusions inquiétantes. Seuls six laboratoires au monde, déclarent ses auteurs, répondent aux normes de sécurité faisant d'eux des lieux indiqués pour les recherches sur les microbes les plus mortels, y compris le virus Ebola, le virus Marburg et le virus de Lassa. L'instabilité politique locale risque de compromettre la sécurité des deux laboratoires situés en Russie et les coupures budgétaires menacent d'avoir le même effet sur les deux laboratoires situés aux États-Unis (Les installations de l'Armée américaine à Fort-Detrick et le CDC à Atlanta) et sur le laboratoire de Grande-Bretagne. Dans le cadre d'une autre étude, l'OMS a envoyé des spécimens de hantavirus (comme celui qui a causé une épidémie au Nouveau-Mexique en 1993) et les micro-organismes responsables de la dengue, de la fièvre jaune, du paludisme et d'autres maladies, aux trente-cinq laboratoires-observatoires de la santé les plus importants du monde. Un seul d'entre eux, le CDC, a correctement identifié tous ces organismes. La plupart des autres en ont correctement identifié moins de la moitié.
En 1994, convaincu que les nouvelles maladies, naturelles ou synthétisées par l'homme, pourraient menacer la sécurité nationale, le CDC avait demandé au Congrès cent vingt-cinq millions de dollars afin d'améliorer ce qu'il décrivait comme un dispositif de surveillance et d'intervention extrêmement inadéquat ; il a reçu un peu plus de sept millions de dollars. Après deux ans d'enquêtes menées par un groupe d'experts, l'Institut de médecine, qui fait partie de l'Académie nationale des sciences, a qualifié la situation de critique.
Cette situation se reflète dans la bataille menée à New-York contre la tuberculose. La lutte contre la souche W de cette maladie, qui est apparue pour la première fois en 1991-92, résiste à tout médicament, tue la moitié de ses victimes et a déjà coûté plus d'un milliard de dollars. En dépit de telles dépenses, on a enregistré trois mille cas de tuberculose à New-York en 1994, dont certains étaient dûs à la souche W. Les rapports annuels du ministre américain de la santé publique des années 1970 et 1980 prévoyaient que la tuberculose serait éliminée aux États-Unis d'ici à l'an 2000. Durant le gouvernement de M. Bush, le CDC indiqua aux autorités du New-York qu'elles pouvaient sans danger réduire les fonds affectés à la lutte contre la tuberculose, affirmant que la victoire sur cette maladie était imminente. À l'heure actuelle, les responsables de la santé publique s'efforcent de ramener le taux d'incidence à son niveau de 1985. On est donc loin de l'élimination de cette maladie. La crise que traverse New-York résulte des pressions de l'immigration (certains malades avaient contracté la tuberculose à l'étranger) et de l'effondrement de l'infrastructure des services locaux de santé publique.
Les moyens d'intervention ont encore empiré au cours des cinq dernières années en raison de contraintes budgétaires. À l'instar de l'OMS qui ne peut pas intervenir lors d'une épidémie si elle n'y est pas invitée par le pays affecté, aux États-Unis, le CDC ne peut intervenir dans un État sans invitation des autorités locales. Le dispositif américain repose sur un réseau de plus en plus précaire de surveillance et d'intervention mis en place par les États et les territoires américains. Une étude réalisée en 1992 pour le CDC montrait que dans douze États, aucun employé n'était chargé de vérifier la contamination microbienne de la nourriture et de l'eau sur le plan local ; dans 67% des États et territoires, moins d'un employé par million d'habitants était chargé d'une telle surveillance. Et seuls quelques États surveillaient les hôpitaux pour déceler l'apparition éventuelle de microbes peu communs ou résistant aux médicaments.
La capacité d'intervention des États repose sur les services de santé publique des comtés et des municipalités et, dans ce domaine également, il y a de profondes lacunes. En octobre, la dengue, fièvre hémorragique qui, partie du Brésil, a régulièrement progressé vers le nord au cours des huit dernières années et dont les effets sont dévastateurs, a frappé au Texas. La plupart des comtés texans avaient considérablement réduit les fonds affectés à la lutte contre les moustiques et ils étaient mal équipés pour combattre les vecteurs du virus de la dengue, des moustiques agressifs originaires du sud-est asiatique. Le même mois, dans le comté de Los Angeles, un trou de deux milliards de dollars dans le budget a amené les autorités à fermer trente-cinq des quarante-cinq dispensaires publics locaux et à mettre en vente quatre des six hôpitaux publics du comté. Le Congrès envisage de réduire considérablement le budget consacré aux programmes « Medicare » et « Medicaid », ce qui, selon l'Association américaine de santé publique, entraînerait une augmentation importante du nombre de cas de maladies infectieuses.
Solutions pour la santé publique
Renforcer les moyens de recherche, améliorer le dépistage des maladies, revitaliser les structures de base de la santé publique, rationner les médicaments puissants pour éviter l'apparition d'organismes qui leur résistent et améliorer les méthodes utilisées dans les hôpitaux pour lutter contre les infections ne sont que des solutions d'attente. La sécurité nationale exige des mesures plus audacieuses.
Une mesure prioritaire consisterait à trouver des moyens scientifiquement valables d'utiliser la réaction ADN-polymérase (habituellement connue sous le nom d'identification à l'ADN), les enquêtes sur le terrain, les déclarations concernant l'exportation de produits chimiques et biologiques, et les instruments juridiques locaux afin de suivre l'évolution d'organismes meurtriers nouveaux ou qui font leur réapparition, qu'ils soient naturels ou qu'il s'agisse d'agents d'armes biologiques. Les travaux devraient se concentrer non seulement sur les microbes présentant un danger direct pour l'homme, mais aussi sur ceux qui pourraient menacer dangereusement les récoltes ou le bétail.
Ce sont souvent les médecins généralistes qui dépistent la plupart des nouvelles maladies. Il n'existe à l'heure actuelle aucun dispositif, pas même aux États-Unis, qui permette au personnel sanitaire de prévenir les autorités compétentes et d'obtenir que l'alerte donnée déclenche sans tarder une enquête. Dans de nombreux pays, les gens qui signalent des cas de maladies infectieuses sont pénalisés, et non pas récompensés, parce que les autorités veulent empêcher la nouvelle de s'ébruiter. Mais l'accès à « Internet » s'améliore à l'échelle mondiale et un investissement modeste permettrait aux médecins, grâce à l'autoroute de l'information, de contacter les autorités sanitaires internationales, contournant ainsi les obstacles dressés par les gouvernements.
Trois maladies seulement, le choléra, la peste et la fièvre jaune, font l'objet de règlements internationaux, ce qui permet à l'ONU et aux autorités nationales d'intervenir, le cas échéant, dans la circulation mondiale des biens et des personnes pour empêcher la propagation de ces épidémies d'un pays à l'autre. Lors de sa réunion annuelle, en 1995 à Genève, l'Assemblée mondiale de la santé, organe législatif de l'OMS, a recommandé que l'ONU envisage l'expansion de la liste de maladies faisant l'objet d'une réglementation internationale et qu'elle trouve de nouveaux moyens de suivre la propagation des maladies. L'épidémie de fièvre d'Ebola survenue à Kikwit a prouvé qu'une équipe de scientifiques internationaux pouvait être mobilisée pour contenir rapidement une épidémie localisée causée par des agents connus transmis par voie aérienne.
Si une épidémie majeure menaçait les États-Unis, l'« Office of Emergency Preparedness » et le « National Disaster Medical System », qui fait partie du ministère américain de la santé et de la protection sociale, seraient aux commandes. Ils ont à leur disposition quatre mille deux cents médecins et infirmiers du secteur privé disséminés à travers les États-Unis et qui pourraient être rapidement mobilisés en cas d'urgence. Ce dispositif est bon, mais il devrait être renforcé. On devrait fournir aux participants des vêtements protecteurs, des respirateurs, des laboratoires mobiles et des installations locales adéquates en vue de l'isolement des contagieux.
En ce qui concerne la menace éventuelle posée par les armes biologiques, le ministère américain de l'énergie a identifié de sérieuses lacunes dans l'application, par la Russie et l'Ukraine, de la Convention sur les armes biologiques. On pense que d'importants stocks d'armes biologiques subsistent dans ces pays et que le personnel du programme soviétique relatif à la guerre biologique est toujours employé par l'État. On croit aussi que des arsenaux d'armes biologiques existent dans d'autres pays, bien que l'on possède peu de renseignements à ce sujet. La localisation et la destruction de ces armes revêtent une haute priorité. Par ailleurs, des scientifiques des États-Unis et d'Europe procèdent à l'identification des gènes conférant leur virulence aux bactéries et aux virus et leur mode de transmission. Une meilleure compréhension des mécanismes génétiques permettra aussi de manipuler les organismes existants et de les doter de dangereuses capacités. Il serait donc prudent que les États-Unis et la communauté internationale étudient dès maintenant cette question et qu'ils envisagent les moyens de contrecarrer de telles activités ou leurs résultats.
Pour être à l'abri de la prolifération des maladies transmises par le sang, l'exportation du sang et celle des animaux doivent faire l'objet d'une réglementation stricte ; les donneurs de plasma sanguin doivent subir des tests de dépistage d'infections et une agence internationale doit être chargée de suivre les rapports signalant l'apparition de nouvelles formes de maladies infectieuses. L'exportation d'animaux de recherche a joué un rôle dans deux incidents survenus l'un en Allemagne, dans lequel des gens travaillant à la fabrication de vaccins ont été infectés par le virus Marburg, et l'autre en Virginie où des singes importés sont morts du virus Ebola.
Selon M. Joshua Lederberg, lauréat d'un Prix Nobel attaché à l'université Rockefeller, les solutions permettant de venir à bout de nouvelles maladies infectieuses sont innombrables et relativement simples ; elles relèvent du bon sens et sont de portée internationale. « Le seul ennui, c'est qu'elles sont coûteuses », précise-t-il.
Les budgets, en particulier celui de la santé publique, sont réduits à tous les échelons gouvernementaux. Pour son interprétation, dans le film « Outbreak », du rôle d'un scientifique chargé de la lutte contre une épidémie, Dustin Hoffman a reçu un cachet d'un montant supérieur au montant global du budget annuel du Centre national de lutte contre les maladies infectieuses et du Programme des Nations unies pour la lutte contre le sida !
Rédactrice médicale et
scientifique au quotidien Newsday, Laurie Garrett est
l'auteur du livre The Coming Plague : Newly Emerging
Diseases in a World Out of Balance (Le prochain
fléau : Les nouvelles maladies dans un monde en
déséquilibre). Cet article a paru dans le
numéro de janvier/février 1996 de Foreign
Affairs
Reproduit avec l'autorisation de FOREIGN AFFAIRS,
Janvier/février 1996. Copyright (c) 1996 by the Council of
Foreign Affairs.