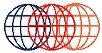
LES AGENTS PATHOGÈNES SONT AU SEPTIÈME CIEL
Judith Randal
![]()
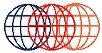
LES AGENTS PATHOGÈNES SONT AU SEPTIÈME CIEL
Judith Randal
![]()
Maintenant que notre millénaire tire à sa fin, la poliomyélite semble avoir disparu et la variole n'existe plus, mais toute une gamme d'autres maladies mortelles ont pris la relève parce que la planète est de plus en plus peuplée et les antibiotiques de moins en moins efficaces.
Jusque dans les années 1950, la variole faisait encore huit millions de morts par an et laissait des séquelles graves pour des millions de personnes. Ces jours-là sont révolus. Grâce à la vaste campagne de vaccination mise en route en 1967 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) jusqu'aux endroits les plus reculés de la planète, aucun cas de variole n'a été recensé dans le monde depuis 1978. De fait, la vaccination n'est même plus nécessaire tant cette croisade a été couronnée de succès. L'éradication de ce mal se traduit par des économies de plusieurs milliards de dollars sur le plan des soins médicaux.
Malheureusement, la variole est la seule maladie infectieuse que l'on ait réussi à éradiquer. À l'approche de l'an 2000, les maladies cardiaques, le cancer et les accidents cérébraux font des ravages chez les personnes âgées, tandis que les virus, les bactéries et les parasites coûtent la vie à plus de seize millions de personnes par an à travers le monde et, dans beaucoup de pays (en particulier dans les pays pauvres), ce sont eux qui constituent la première cause de décès des enfants et des jeunes adultes.
Certes, on peut se féliciter des petits pas qui ont été faits récemment dans la bonne direction, et notamment de l'éradication de la poliomyélite dans le continent américain grâce à la mise en place d'un dynamique programme de vaccination qu'a financé en grande partie un organisme privé, le « Rotary International ». Considérée dans son ensemble, la situation ne s'est pas pour autant améliorée, et la plupart des spécialistes craignent même qu'elle n'ait empiré lorsqu'ils la considèrent sous l'angle de la propagation de micro-organismes mortels.
À cet égard, l'un des indicateurs les plus alarmants tient à la baisse progressive de l'efficacité des antibiotiques, phénomène que l'on a observé pour la première fois en Nouvelle-Guinée voilà trente ans, mais qui s'est généralisé depuis.
« Il est vrai que les antibiotiques n'ont jamais eu d'effet sur les virus, mais il fut un temps où nous pouvions compter sur eux pour enrayer la plupart des autres infections.De nos jours, la probabilité que la tuberculose, la pneumonie bactérienne, les infections à streptocoque ou à staphylocoque, et bien d'autres agents pathogènes encore, céderont aux antibiotiques diminue presque quotidiennement », déclare le docteur Gail Cassell, professeur de microbiologie à l'université d'Alabama, à Birmingham.
Ces médicaments perdent de leur prestige parce que plus on les utilise, plus le nombre de microbes qui y sont sensibles diminue. Comme l'explique le docteur Cassell, « tout antibiotique devient, tôt ou tard, victime de son succès ». Ce qui empire encore les choses, c'est que les microbes doivent leur résistance à des portions de patrimoine génétique que diverses souches, voire diverses espèces, peuvent mutuellement échanger. Il est donc de plus en plus difficile de fabriquer des antibiotiques suffisamment vite pour remporter la victoire.
Les maladies infectieuses posent une menace croissante pour bien d'autres raisons, et notamment parce que le monde est de plus en plus peuplé. En conséquence, les agents pathogènes disposent d'un nombre croissant de cibles. Alors qu'elle comptait deux milliards et demi d'habitants il y a cinquante ans seulement, la planète en compte aujourd'hui six milliards, et leur nombre va croissant. Les répercussions sur l'environnement, pour ne retenir que cette conséquence, se révèlent désastreuses pour la santé publique.
Ainsi, le déboisement qui découle de la nécessité de défricher afin d'installer de nouveaux groupements de populations ou de satisfaire aux besoins humains, agricoles entre autres, a multiplié les risques de contact entre les hommes et aussi bien des microbes connus que des micro-organismes peu connus, tels le virus Ebola ou celui de la fièvre de Lassa, tous les deux mortels et identifiés respectivement pour la première fois au Zaïre et au Nigéria. La recrudescence du paludisme au Brésil, imputable en grande partie à l'exploitation des gisements d'or dans la jungle amazonienne, illustre bien ce phénomène. Cette maladie se révèle d'ailleurs particulièrement inquiétante, parce que le micro-organisme à l'origine de sa forme la plus virulente, « Plasmodium falciparum », cède de moins en moins aux médicaments. Il n'existe pas de vaccin contre le paludisme.
Ajoutons à cela que la croissance démographique entraîne l'expansion urbaine dans sa foulée. Le professeur Donald Henderson, qui a dirigé la campagne d'éradication de la variole et qui enseigne maintenant à la faculté de santé publique de l'université Johns-Hopkins, à Baltimore, ne perd pas une occasion de rappeler à ses étudiants que deux villes au monde seulement, à savoir New-York et Londres, atteignaient la barre des 7,5 millions d'habitants en 1950. « À l'heure actuelle, dit-il, trente villes sont dans cette situation, et sept d'entre elles pourraient facilement doubler ce chiffre sous peu. »
Cette constatation est d'autant plus troublante que la plupart des nouvelles mégalopoles se situent dans des pays dont les pouvoirs publics n'ont pas les moyens de s'attaquer aux problèmes liés à la médiocrité des conditions sanitaires, au surpeuplement, à la pénurie d'eau potable et aux autres facteurs de la propagation des infections qui affligent un nombre sans cesse croissant de pauvres établis en milieu urbain. Comble d'infortune, ajoute le professeur Henderson, les guerres civiles qui sévissent en Asie, en Afrique et dans l'ancienne Yougoslavie aggravent encore le problème, parce qu'elles créent des dizaines de millions de personnes déplacées et de réfugiés, lesquels passent souvent des mois, voire des années, dans des camps sordides ou dans les bidonvilles des mégalopoles, lieux de prédilection des agents pathogènes.
De graves cas de choléra se sont par exemple déclarés parmi les quelque cinq cent mille Rwandais en quête d'un refuge au Zaïre que les conflits ethniques avaient chassés de leurs foyers. Maintenant que le conflit s'étend au Zaïre, le nombre de réfugiés dépasse le million et le risque d'infections empire lui aussi. Il existe bien un vaccin contre le choléra, mais son efficacité laisse à désirer. Du reste, comme la plupart des vaccins, celui-ci doit être réfrigéré, ce qui tient du tour de force en Afrique centrale.
Le professeur Henderson en tire les enseignements suivants : « Notre lutte contre la variole, contre le virus Ebola et contre la fièvre de Lassa nous a appris que les micro-organismes à l'origine des maladies, tout au moins dans le monde en développement, se transmettent surtout lorsque le personnel sanitaire et les visiteurs y sont exposés en milieu hospitalier et qu'ils les propagent ensuite dans la collectivité. De fait, on peut supposer que le sida a commencé ainsi. Mais il est clair également que les agents pathogènes se propagent aussi facilement dans les hôpitaux que dans les installations réservées aux réfugiés, les bidonvilles et les foyers accueillant les personnes sans domicile fixe dans les pays industriels. »
Cela dit, à une époque où il ne faut pas plus de trente-six heures pour aller d'un point du globe à un autre, il serait bien naïf d'imputer la recrudescence des maladies infectieuses exclusivement à la dégradation de l'environnement, aux hôpitaux et aux conditions dans lesquelles doivent vivre les habitants des bidonvilles, les réfugiés et les sans-abri. La multiplication phénoménale des déplacements internationaux et l'expansion du commerce mondial ont elles aussi leur place au banc des accusés.
En 1986, par exemple, des moustiques vecteurs du virus qui provoque la dengue et plusieurs autres virus, notamment celui de l'encéphalite, ont été découverts aux États-Unis sur des pneus importés d'Asie du Sud-Est. Plus récemment, des cas de paludisme observés chez des employés des aéroports de Londres et de New-York ont été liés à la présence de moustiques dans des avions de ligne en provenance de pays tropicaux.
Cependant, l'importation d'agents pathogènes dans des milieux qui ne font normalement pas partie de leur habitat n'est pas toujours en cause. Il arrive parfois que l'adoption de nouvelles techniques favorise leur multiplication. Par exemple, la schistosomiase a considérablement repris du terrain en Egypte à la suite de la construction sur le Nil du gigantesque barrage hydro-électrique d'Assouan en 1968.
La schistosomiase, ou bilharziose, est une maladie parasitaire transmise par des mollusques d'eau douce porteurs de certaines espèces de vers. En créant le lac Nasser et en ralentissant le cours du fleuve, le barrage d'Assouan a provoqué l'accroissement du nombre des mollusques en aval. C'est un problème que l'on n'a pas encore réussi à résoudre, ni en Egypte ni dans les autres pays où sont construits de grands barrages, comme au Soudan et au Ghana.
La schistosomiase ne semble pas être la seule maladie imputable aux travaux de cette nature, puisqu'ils pourraient avoir eu le même effet en ce qui concerne une autre maladie virale transmise par les moustiques. Naguère, la fièvre de la vallée du Rift ne frappait pratiquement que le bétail. Or, depuis la fin de la construction du barrage d'Assouan, l'Egypte doit faire face à des épidémies de cette maladie chez l'homme. D'autres pays, dont le Sénégal, la Mauritanie et Madagascar, se heurtent aux mêmes difficultés.
À la lumière de ces exemples, on pourrait croire que seuls les progrès techniques qui transforment le paysage entraînent ce genre de répercussions, et ce uniquement dans les pays à l'infrastructure moderne insuffisante. En fait, les preuves du contraire abondent.
Ainsi l'Angleterre a-t-elle appris, à son grand malheur, que le bétail nourri avec des farines alimentaires contenant une protéine dérivée du mouton produit une viande dont la consommation risque de provoquer chez l'homme une affection neurologique d'évolution toujours fatale, dite maladie de Creutzfedlt-Jacob, ce qui ne se produirait pas si on laissait le bétail brouter l'herbe dans les pâturages. Les répercussions économiques de cette découverte sont extraordinaires. L'Angleterre a dû abattre des centaines de milliers de bestiaux qui avaient consommé cette protéine, parce qu'ils avaient contracté une maladie analogue, dite encéphalite spongiforme bovine ou, plus familièrement, « maladie de la vache folle », et des millions d'autres ont dû être détruits, parce qu'il a été prouvé, presque sans l'ombre d'un doute, que le mouton pouvait héberger l'agent infectieux responsable de cette maladie.
Mais la contamination des aliments ne s'explique pas uniquement par la modification des pratiques agricoles. On s'est en effet aperçu que la transformation des structures de distribution et de commercialisation avait son importance. En 1993, l'apparition de cas d'infections dues à la bactérie Escherichia coli 0157:H7, d'abord dans le nord-ouest des États-Unis, puis dans vingt et un États, l'a bien confirmé.
Comme toutes les personnes qui avaient contracté cette infection -et dont certaines en sont mortes- avaient consommé des hamburgers dans des établissements de restauration rapide, on a vite trouvé l'origine de la maladie. Il restait à savoir d'où provenait cette viande contaminée. Des spécialistes de la santé publique durent se rendre à l'évidence : il leur était impossible de cerner précisément l'origine de la viande hachée, parce que les établissements qui l'avaient servie s'étaient approvisionnés dans une demi-douzaine d'États sur le territoire américain et auprès d'au moins deux pays étrangers.
La situation ne manquerait déjà pas d'inquiéter si la viande de bœuf était le seul aliment dont il faille se méfier. En réalité, les ramifications du problème sont multiples, parce que les produits alimentaires consommés dans le monde, qu'il s'agisse de la viande, de la volaille, du poisson, des fruits de mer, des fruits, des légumes, des produits laitiers, des aliments préparés et même de l'eau en bouteille, ne sont pas achetés, vendus, transformés ou distribués sur place. On leur fait souvent parcourir des trajets impressionnants.
Étant donné la mondialisation du marché et la myriade d'occasions propices à la contamination par de nombreux agents infectieux tout au long du parcours, même les pays les plus riches manquent de moyens, financiers et autres, pour les intercepter tous.
Il y a, hélas, d'autres préoccupations. Prenons, par exemple, le cas des changements climatiques. Personne ne comprenait les raisons de l'explosion de cas d'hantavirus dans le sud-ouest des États-Unis en 1993. On n'y avait encore jamais décelé la présence de ce virus, transmis par la voie aérienne, qui provoque des lésions pulmonaires d'évolution pouvant se révéler fatale.
En réunissant plusieurs indices indirects, on a fini par imputer le problème à la fonte d'une grande quantité de neige, suivie par des pluies torrentielles, et ce après des années de sécheresse. Plus précisément, on a constaté que l'abondance inhabituelle d'eau avait favorisé la production de pignons, nourriture préférée d'une certaine espèce de souris hébergeant cet hantavirus, et que la population de ces souris s'était fortement accrue. Contraints d'élargir leur territoire parce qu'ils étaient eux-mêmes devenus plus nombreux, ces petits rongeurs, que l'hantavirus ne rend pas malades, ont fait des victimes chez les personnes qui avaient eu la malchance d'inhaler des particules de poussière contaminées par leur urine et leurs matières fécales contenant le virus.
Le cas du virus « morbilli » illustre bien à quel point l'étude des agents pathogènes infectieux peut rendre la communauté scientifique perplexe, mais aussi la fasciner. Plusieurs virus font probablement partie de cette même catégorie, et il semble provenir de celui qui provoque la maladie de Carré, chez les jeunes chiens. Les hommes s'étant établis, avec leurs chiens, à la lisière du parc national de Serengeti le long de la frontière avec la Tanzanie, il est possible que ce soit à ces derniers que l'on doive la mort d'un tiers des lions de cette réserve. En revanche, on comprend moins bien que le virus « morbilli » ait tué des phoques et des tortues de mer dans plusieurs régions du monde et que le « morbilli » équin ait provoqué le décès non seulement de chevaux infectés en Australie, mais celui aussi de deux de leurs entraîneurs.
Il n'y a pas si longtemps encore, la médecine fondait tant d'espoir dans la panoplie d'armes à sa disposition afin de combattre les infections (médicaments et vaccins) que ses sommités affirmaient qu'il était temps de demander aux chercheurs de consacrer toute leur énergie aux maladies dégénératives liées à la vieillesse et à d'autres affections non contagieuses.
La survenue du sida au début des années 1980 et sa propagation dans le monde entier ont ébranlé leur sentiment d'auto-satisfaction. La leçon qu'il faut en tirer, personne ne la prêche mieux que le professeur Stephen Morse. Après une longue carrière à l'université Rockefeller de New-York, ce virologue à qui l'on doit le terme d'infections « émergentes » a récemment rejoint l'équipe des chercheurs d'un organisme rattaché au ministère de la défense des États-Unis, la « Defense Advanced Research Projects Agency », situé en banlieue de Washington.
Nous avons grand tort, affirme le professeur Morse, de ne pas faire cas de la capacité qu'ont les virus, les bactéries et les parasites d'exploiter à leur avantage la modification de leur environnement. Beaucoup de gens commencent maintenant à se rallier à son point de vue.
Mme Judith Randal, ancienne présidente
de l'Association nationale des rédacteurs
scientifiques,
écrit des articles sur la santé
et la médecine pour diverses revues, dont The
Economist.
![]()
Dossiers
mondiaux
Revues électroniques de l'USIA, volume 1,
numéro 17, novembre 1996